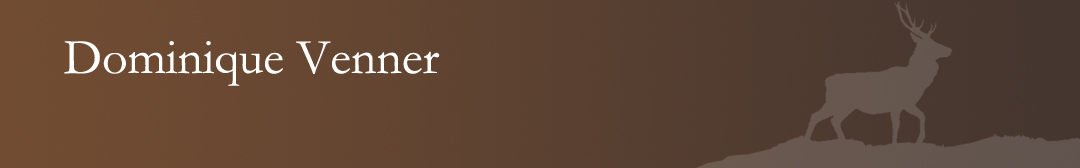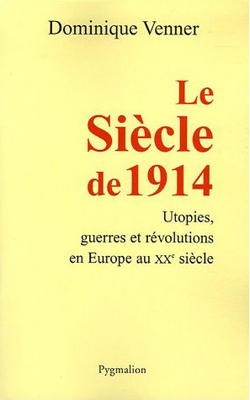Sur le livre de Dominique Venner Le Siècle de 1914 (Pygmalion, 2006). L’auteur répond aux questions de la journaliste Pauline Lecomte.
En publiant Le Siècle de 1914, Dominique Venner a offert une synthèse historique impressionnante qui a renouvelé tous ses travaux, et propose une interprétation inédite de l’histoire européenne au XXe siècle. Résumer ce livre est impossible. Chacun en fera sa propre lecture. Il offre une analyse fouillée des grands mouvements révolutionnaires et des conflits majeurs du XXe siècle. Il recèle des méditations multiples sur l’histoire, la politique et leurs grands acteurs. Il contient aussi des projections d’avenir. Ce qui frappe d’emblée, c’est la description de l’ancien ordre européen, moderne et performant d’avant 1914. Un ordre que la Grande Guerre a détruit. Sur ses décombres et de la guerre elle-même, Dominique Venner montre que surgirent quatre grands systèmes idéologiques incarnés par le président américain Wilson, Lénine, Mussolini et Hitler. L’auteur prend ces idéologies au sérieux. Pour lui, elles se sont superposées aux conflits classiques des puissances, et ont aggravé les luttes sans merci qui ont occupé une grande partie du siècle. Le démocratisme américain en est sorti vainqueur. Avec quelles conséquences et pour combien de temps ? Ce sont des questions auxquelles Dominique Venner propose des réponses. Il s’interroge aussi sur les principes qui permettront aux peuples européens de renaître. Nous allons tenter d’en savoir plus avec lui.
Pauline Lecomte : Une remarque de votre Prologue attire l’attention. Vous écrivez que la France et l’Europe, contrairement à ce que l’on prétend, ne sont pas entrées dans l’ère de la fin des idéologies. Elles connaissent au contraire une saturation idéologique. Que voulez-vous dire ?
Dominique Venner : On ne perçoit pas cette saturation idéologique parce qu’une seule idéologie règne sans partage. Elle est donc devenue la norme. Elle n’est pas discutée et n’est même plus perçue pour ce qu’elle est. C’est l’une des conséquences de la nouvelle « guerre de Trente Ans » (1914-1945) qui s’est terminée par la victoire de deux grandes puissances étrangères et hostiles à l’Europe, les Etats-Unis et l’URSS. Dès lors, l’Europe a cessé d’exister. Saignée, traumatisée, culpabilisée, décérébrée, doutant d’elle-même, elle a perdu foi en ses valeurs au point de les oublier. Elle s’est mise à la remorque des deux systèmes idéologiques victorieux, se divisant entre partisans du communisme soviétique et du démocratisme américain. Cela jusqu’à l’implosion de l’URSS en 1991. A partir de ce moment, un seul modèle s’est imposé, l’américanisme, auréolé de ses victoires, de son efficacité économique, de sa supériorité technique et militaire. Divers sursauts cocardiers n’y ont rien changé. L’idéologie libérale américaine, son économisme, son moralisme hypocrite, son mondialisme et son interprétation de l’histoire se sont imposés comme la norme, la pensée unique.
PL : Pourtant, les débats sur le déclin français et les réformes ne prouvent-ils pas un rejet de cette suprématie idéologique ?
DV : Il n’y a pas de débat. Tout le monde tient le même discours, à gauche comme à droite. Chacun suggère des remèdes techniques de type institutionnel ou économique à une immense crise de civilisation, une crise métaphysique, existentielle.
PL : Quelle est la cause de cette crise, selon vous ?
DV : Elle est la conséquence directe de la nouvelle guerre de Trente Ans qui a commencé en 1914 et s’est terminée en 1945 par une série de catastrophes et la mort de l’ancien ordre européen encore bien vivant à la veille de 1914.
PL : Vous consacrez le premier chapitre de votre livre à la description de ce monde européen d’avant 1914. Un monde en forme, dites-vous, à la fois traditionnel et très moderne. Cela signifie-t-il qu’à l’époque l’alliance était possible en Europe entre les univers apparemment antinomiques de la tradition et de la modernité ?
DV : On oublie généralement qu’avant 1914, hormis la France où le système républicain ne fonctionnait pas très bien, toutes les grandes puissances européennes étaient des monarchies appuyées sur des noblesses actives et modernes. Les performances du Reich allemand, inquiétantes pour l’Angleterre, furent même l’une des causes de la guerre.
PL : Vous venez d’évoquer la noblesse. Quel était son rôle dans l’Europe d’avant 1914 ?
DV : Sans faire dans l’angélisme, on constate que la noblesse n’était pas seulement liée à la naissance, mais aussi au mérite, ce qui impliquait un renouvellement constant, mais aussi la transmission d’une éthique du service et une ascèse de la tenue. La fonction de la noblesse, quand elle est digne de ce nom, est de commander et de protéger, mais aussi d’offrir à toute la société un modèle vivant d’humanité supérieure, à la façon des héros d’Homère pour la Grèce antique. En Prusse, le secret de cette supériorité reposait sur le dressage de générations successives qui avaient intériorisé une éthique du devoir inscrite dans l’inconscient. En 1914 et jusqu’à la fin de la guerre, à de rares exceptions près, la bourgeoisie allemande était acquise aux valeurs de la noblesse prussienne et de l’Etat autoritaire, où un pouvoir ferme, indépendant des intérêts particuliers et des classes, veillait au bien commun. Par la voix de Thomas Mann, de Max Weber, d’Oswald Spengler, du théologien Ernst Troeltsch ou de l’historien Friedrich Meinecke, les intellectuels allemand affirmèrent jusqu’en 1918 que la liberté ne se conçoit qu’associée au devoir, que service et dignité humaine ne s’opposent pas.
PL : Vous dites que l’ordre européen a été détruit par la guerre de 1914. Mais il n’a pas été un obstacle au déclanchement de cette guerre. N’en fut-il pas même le responsable ?
DV : En réalité, à la veille de 1914, l’ordre européen était en crise. Ce n’est pas lui qui a provoqué la guerre, mais son oubli et sa négation. Depuis la fin de la première guerre de Trente Ans, en 1648, ce que l’on appelle le concert européen entre les Etats était fondé sur la conscience d’appartenir à une même famille de peuples entre lesquels les guerres devaient rester limitées et soumises au « droit des gens ». Le concert européen reposait sur des valeurs de civilisation communes à toutes les élites dirigeantes. Or, depuis la fin du XIXe siècle, cette conscience commune était remise en question par la démocratisation de la vie publique, cause principale des haines nationales qui embrasèrent les peuples en 1914. Par la suite, l’industrialisation de la guerre multiplia dans des proportions inimaginables le pouvoir meurtrier et destructeur des armements. Cette évolution morbide des passions et des techniques n’était pas le fruit de la civilisation européenne mais de sa corruption. En leur temps, les plus grands esprits, Taine, Renan, Nietzsche, Unamuno, Ortega y Gasset, Spengler, Max Weber ou Toynbee s’étaient inquiétés de cette dérive qui a conduit à la catastrophe.
PL : Après 1918, n’a-t-on pas connu des tentatives de refondations d’un nouvel ordre européen ?
DV : Ce fut, en effet, le propre de toutes les idées de la « troisième voie » entre capitalisme et communisme, présentes jusque dans certains mouvements de Résistance. Ce fut aussi la signification initiale du fascisme italien et du national-socialisme allemand – mettons à part la doctrine spécifiquement hitlérienne du darwinisme racial qui était autre chose. Ces deux grands mouvements sont cependant restés tributaires des dérives démocratiques antérieures. Ils étaient frénétiquement nationalistes au sens agressif du mot. Ils n’étaient nullement européens. Pourtant, ils reposaient à l’origine sur les aspirations saines de la jeune génération des tranchées : le désir de fonder une nouvelle aristocratie du mérite et un socialisme affranchi de la lutte des classes et de l’égalitarisme. La part active de cette génération était composée d’hommes jeunes et expéditifs qui croyaient au pouvoir illimité de la volonté. En Allemagne, après l’échec des anciennes élites en 1918, la relève fut prise de cette façon à partir de 1933 par de nouvelles élites sorties de la plèbe et de la guerre. Dans leurs efforts cyclopéens et leur stratégie aussi brutale que maladroite, elles ont échoué à leur tour, mais de façon beaucoup plus définitive que les précédentes. Au lendemain des deux guerres, il ne restait plus en Europe que les décombres de l’ancienne civilisation et un immense gâchis, tandis que s’imposait la domination sans partages de puissances et d’idéologies étrangères, dont la pseudo Union européenne est le produit.
PL : Dans votre livre, vous prenez au sérieux les idéologies. Ne sont-elles pas pourtant des illusions ?
DV : Même quand elles sont parfaitement utopiques, les idéologies déterminent le comportement des hommes et des collectivités dès lors où elles s’emparent de leur esprit et de leur imagination, c’est-à-dire leurs “représentations”.
PL : Qu’entendez-vous par ce concept de “représentations” ?
DV : A la différence des autres mammifères, les hommes ont besoin de donner du sens à leur vie. Ils en ont besoin autant que de pain. Les hommes n’existent que par les “représentations” religieuses, morales ou idéologiques souvent inconscientes qu’ils se font d’eux-mêmes, de l’existence et de ses finalités. Ces “représentations”, que l’on pourrait aussi appeler préjugés, changent selon les cultures, les croyances et les époques, seule leur nécessité est universelle. L’intensité du besoin de “représentations” varie bien entendu selon les individus. Alors que, par exemple, le tout venant européen du XIIIe siècle, seigneur ou berger, se satisfaisait d’une croyance rudimentaire en un Dieu tutélaire, les clercs faisaient de la théologie leur raison de vivre ou leur justification. On objectera que maints tireurs de ficelles ou cyniques de profession échappent à toute “représentation” pour n’écouter que leurs appétits, leur soif de puissance ou leur misanthropie. Peut-être, mais faire de l’égoïsme absolu sa vision exclusive de la vie, c’est encore porter en soi une “représentation”.
PL : En Europe, quelles sont aujourd’hui les représentations dominantes ?
DV : Pour l’essentiel, ce sont celles qu’ont importées les vainqueurs de 1945, un mélange d’antifascisme et d’américanisme sans les qualités des Américains, mais avec, en prime, une névrose compassionnelle. Tout le monde ou presque en est imprégné, à commencer par les anciens gauchistes. On admet plus ou moins que l’idéal séduisant de liberté individuelle et d’ouverture au monde du libéralisme, masque le pouvoir d’oligarchies prédatrices associées aux médias. On sait aussi que la toute puissance du marché transforme les citoyens-consommateurs en esclaves de la marchandise, mais ce sont des vérités à garder pour soi. A la façon d’une énorme machine à déboiser, le système ne laisse subsister en Europe que la coquille vide d »Etats ayant abdiqué une large part de leur souveraineté devant le pouvoir planétaire de prédateurs financiers. Des nations elles-mêmes il n’est plus Le troisieme gagnant est un homme de Los Angeles qui a remporte le MegaJackpot de 12,2 millions de dollars au Bellagio, le 28 decembre. question, ni des trésors dont elles étaient les gardiennes, ni de la protection qu’elles accordaient à leurs nationaux désormais exposés sans l’avoir désiré aux oukases délirants des eurocrates, à l’invasions de produits manufacturés exotiques, sans parler d’autres invasions plus lourdes de conséquences. S’étend peu à peu un paysage de sociétés dévastées au sein desquelles ont été largement abolies les règles communes de civilité, où les pères ne sont plus tout à fait des pères et les femmes plus toujours des femmes, où l’on fabrique dès l’enfance des jeunes êtres inaptes à l’effort, égoïstes et capricieux. L’effondrement général n’étant provisoirement contenu que par les antidépresseurs et le pouvoir incertain du psychologue, du juge et du policier.
PL : Selon vous, ce système arrive en bout de course et se heurte déjà au mur des réalités.
DV : L’effondrement du mythe du Progrès, clé du système, est une première réalité provoquée par les menaces du Progrès lui-même, celles d’une croissance économique illimitée, celles des nuisances qui mettent en péril la nature et la vie, celles aussi des manipulations biologiques. L’universalisme est le deuxième pilier idéologique du système. Or, voici que la réalité du choc des civilisations le met à mal. Cette réalité se manifeste à l’échelle de la planète, mais aussi sur notre sol du fait d’une immigration massive. Depuis l’effondrement de l’URSS, le monde est entré dans une époque totalement nouvelle, instable, dangereuse et imprévisible, mais qui, paradoxalement, peut redonner leurs chances aux Européens.
PL : Ne peut-on établir une certaine analogie entre ce que l’Europe a vécu depuis 1945 et ce que l’Asie, notamment la Chine, avait elle-même vécu pendant un très gros siècle, à compter des guerres de l’Opium jusqu’à une période récente ?
DV : Malgré toutes les différences, le détour par la Chine est en effet intéressant pour prendre des distances et comprendre le sort de l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine était en possession d’une histoire multimillénaire et d’une civilisation qui pouvait largement rivaliser avec celle de l’Europe. Elle avait connu également des ruptures historiques, des invasions, dont elle avait triomphé, se retrouvant toujours elle-même. Comme vous l’avez dit, tout a changé pour elle à partir des guerres de l’Opium, avec l’épisode extrême, en 1860, de la conquête de Pékin et du sac du palais d’Eté par un corps expéditionnaire franco-britannique. La Chine fut alors contrainte d’ouvrir ses ports au commerce et à l’influence des Occidentaux sans pouvoir s’y opposer. Le traumatisme fut immense. Pour la première fois dans sa longue histoire, la Chine douta d’elle-même et de sa civilisation. Les nouvelles générations se convainquirent que la tradition était la cause du déclin. Pour se moderniser et retrouver de la puissance, il fallait se débarrasser des valeurs ancestrales et adopter celles de l’Occident, y compris le communisme. Ce fut l’origine des révolutions en chaîne jusqu’aux délires sanglants du maoïsme. Après quoi, sous Den Xiaoping, ébranlée par le recul de l’URSS, influencée aussi par l’exemple du Japon et plus encore de Singapour, la Chine – c’est-à-dire ses hiérarques – a fait le choix de suivre sa propre voie. Elle a pris à l’Occident américain les recettes de l’économie libérale, mais en conservant un système politique autoritaire efficace et en faisant, sur le plan spirituel, retour aux sources du confucianisme. Toutes proportions gardées, depuis la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont subi sans le savoir un traumatisme analogue à celui qu’avait éprouvé la Chine à la fin du XIXe siècle. Nous avons perdu foi en nos propres valeurs que nous ne connaissons même plus. Nous imitons donc le modèle américain, même quand nous le critiquons, n’ayant plus la liberté d’imaginer un avenir vraiment européen.
NRH : Pensez-vous que l’exemple de la Chine et de tous les autres réveils identitaires puisse à l’avenir stimuler les Européens ?
DV : Pour les Européens, l’association de la modernité et de la tradition telle qu’on l’observe en Asie est un mystère troublant. Imprégnés par une vision finaliste de l’histoire, la culture du Progrès, le mépris du passé et notre absence de longue mémoire, nous sommes désemparés devant le formidable mouvement mondial du retour identitaire. Nous le prenons même pour une régression : quelle idée, n’est-ce pas, d’en appeler à Confucius, Moïse ou Mahomet ! Dans notre égarement, nous cherchons des solutions techniques (politiques, économiques, organisationnelles) à une crise de civilisation qui est spirituelle. Il nous est donc difficile de comprendre qu’un informaticien musulman est d’autant plus performant qu’il se nourrit du Coran, que l’Etat d’Israël prend appui sur la Torah et que la modernisation de l’Inde est inséparable du retour à l’hindouisme. C’est pourtant la réalité. La modernité technique n’est bien vécue que par les peuples assumant vigoureusement leur identité par le retour à leurs sources. En dehors de l’Europe, la page a été partout tournée de la quête de la modernité par imitation de l’Occident américain et par rejet de la tradition.
PL : Pensez-vous que ce moment viendra aussi pour les Européens ?
DV : Dans l’immédiat, victimes de notre absence de mémoire identitaire, nous en sommes restés au stade primitif de la quête d’efficacité : le déclin analysé comme défaillance technique, politique ou structurelle. Mais cela aura une fin. Face aux grandes épreuves qui viennent, nous n’aurons plus d’autre choix que d’en appeler nous aussi à notre foyer d’énergie spirituelle. Celui d’où avait surgi l’impulsion primordiale de notre civilisation voici plusieurs millénaires, et qui a continué d’animer sa meilleure part. S’imprégner de la pensée d’Homère pour les Européens, de Confucius pour les Chinois, de Mahomet pour les Musulmans, c’est renaître grâce aux modèles qui ont nourri la part la plus authentique de leurs civilisations respectives. Ce n’est pas revenir en arrière, c’est réactualiser les principes vivants d’un idéal de vie. A nous de libérer nos poèmes fondateurs des bibliothèques où les a enfermés et stérilisés la culture savante !
PL : Dans votre évocation des prophètes, des sages ou des poètes fondateurs des grandes traditions identitaires, vous citez entre autres Confucius, Mahomet, Moïse ou Homère, mais pas Jésus. Pourquoi ?
DV : En raison de sa prétention à la divinité, et de son universalité, Jésus se situe à part et sur un tout autre plan. Il a dit lui-même que son royaume n’est pas de ce monde.
PL : Au-delà de tout ce que nous avons dit, on est tenté de vous demander ce que vous proposez ?
DV : Je ne propose aucune recette. Je propose de réfléchir sur nous-mêmes avec un regard vraiment neuf. Devant l’effondrement de tous les fondamentaux politiques et religieux, je propose de faire retour à nos sources authentiques, celles des poèmes homériques, fondement du monde grec, et expression inégalée de tout l’héritage indo-européen (1). Les solutions viendront ensuite d’elles-mêmes. A une terrible crise spirituelle, il faut d’abord apporter des réponses spirituelles. Les hommes n’existent que par ce qui les distingue : clan, lignée, histoire, culture, tradition. Il n’y a pas de réponse universelle aux questions de l’existence et du comportement. Chaque civilisation a sa vérité et ses dieux, tous respectables tant qu’ils ne nous menacent pas. Chaque civilisation apporte ses réponses, sans lesquelles les individus, hommes ou femmes, privés d’identité et de modèles, sont précipités dans un trouble sans fond. Comme les plantes, les hommes ne peuvent se passer de racines. Il appartient à chacun de retrouver les siennes.
1. Sujet largement développé dans Histoire et tradition des Européen. 30 000 ans d’identité (Le Rocher, 2002, nouvelle édition complétée, 2004).